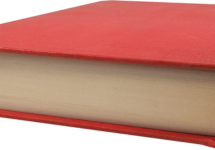Aucun d’entre eux n’a véritablement avancé alors même que la parution début novembre du cinquième rapport du GIEC montre que l’homme est désormais de façon quasi-certaine le responsable du réchauffement climatique, que la concentration de CO2 ne cesse d’augmenter dans l’atmosphère et que, face à l'ampleur du réchauffement, il faut agir vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Certains commentateurs s’en désespèrent et s’inquiètent du devenir de la Conférence de Lima, puis de celle de Paris : ils ont tort. La préparation des différents sommets climatiques a toujours été marquée par une succession de phases de stagnation voire de recul, suivies par des phases d’accélération. Le surplace de la réunion de Bonn fin octobre n’est donc très probablement qu’un épiphénomène qui obligera les délégués à devoir s’entendre plus rapidement que prévu à Lima fin novembre.
Les questions de procédure constituent un rituel de ces négociations. Le début de la conférence de Lima reprendra un point qui a soulevé de vives réactions à Bonn et sera donc consacré à la méthode de travail : faut-il discuter à partir d’un document préparé par des rapporteurs ? Faut-il travailler sur un projet de texte final ? Ou faut-il se concentrer sur des points clefs ? Au-delà de ces questions procédurales, certes importantes, mais dont l’intérêt n’est pas toujours évident, deux questions non résolues jusqu’à présent méritent cependant d’être soulignées.
La première porte sur la distinction - certains diraient la fracture - qui sépare depuis le premier Sommet de la Terre les pays riches des pays pauvres. La Convention cades des Nations-Unies sur le changement climatique adoptée en 1992 distingue en effet les pays riches qui, au terme du protocole de Kyoto, se sont engagés à réduire leurs émissions, des pays pauvres qui ne sont soumis à aucune contrainte. Cette division du monde doit-elle subsister ? Oui, pour les pays en développement qui soulignent la responsabilité historique des pays développés dans les émissions passées ; non, pour les pays développés qui ont beau jeu de montrer que, désormais, les pays émergents émettent quasiment autant de gaz à effet de serre qu’eux.
Dans un futur accord, dit bottom up dans lequel chaque pays choisit ses engagements de réduction, cette distinction pourrait et devrait ne plus guère avoir de sens : à chaque Etat de faire ce qu’il peut, qu’il soit pays développé, pays émergent ou pays en développement. Elle peut cependant conduire à un véritable blocage. Dans un discours à l’université de Yale, mi-octobre, le principal négociateur américain, Todd Stern, tout en reconnaissant que la priorité des pays en développement est de réduire la pauvreté et que le recours aux hydrocarbures a traditionnellement été le meilleur moyen de favoriser la croissance économique, s’oppose fermement à la reconduction d’une distinction qui lui apparaît dater d’une autre époque. Il ajoutait même que si les pays en développement voulaient absolument préserver ce système à deux niveaux, ce serait un point de rupture pour les Etats-Unis. A l’inverse, les pays émergents lors de leur sommet du mois d’août en Inde ont souligné que le futur accord devrait respecter les principes de la convention–cadre de 1992 en particulier ceux d’équité et de responsabilité commune mais différenciée, autrement dit la distinction entre pays riches et pays en développement. Le ministre indien soulignait pour sa part juste après le sommet de Bonn que cette distinction devait constituer l’un des éléments du nouvel ordre mondial dans la lutte contre le changement climatique.
Dans une démocratie des Etats dans laquelle chacun adopte ses propres engagements, cette distinction est de plus en plus dépourvue de sens : les Chinois vont probablement tout faire pour passer par un pic de leurs émissions dans les prochaines années, les Américains réduiront les leurs grâce au progrès technologique et grâce à une certaine évolution de leur mode de vie ... Les Brésiliens proposent ainsi de classer les pays suivant des cercles concentriques qui correspondraient à l’ampleur de leurs engagements : dans le cercle intérieur, se trouvent les pays qui s’engagent à réduire leurs émissions, les plus éloignés du centre sont ceux qui n’adoptent aucune mesure particulière contre le changement climatique. L’idée brésilienne consiste à dire qu’au terme de l’accord chaque pays doit être incité à se rapprocher du centre : elle permet ainsi de regarder sous une perspective tenant compte des réalités actuelles et évolutive dans le temps la distinction binaire pays riches/pays pauvres.
La deuxième question porte sur le financement. A Copenhague, puis à Cancún, les pays développées se sont engagés à verser une aide publique immédiate (dite “fast start”) de 30 milliards de dollars de 2010 à 2012, puis à augmenter progressivement ce montant qui devrait atteindre 100 milliards annuels en 2020. La crise économique et ses effets ont conduit les pays développés à à oublier cette promesse au regard de leurs contraintes budgétaires : le Fonds vert qui devait en être le principal instrument n’a pour le moment reçu qu’un montant de 3 milliards de dollars (dont un en provenance de la France) : les pays en développement attendent 15 milliards de dollars. Cette somme ne constitue de plus que la capitalisation initiale du fonds.
Cette promesse de financement et notamment les 100 milliards à l’horizon 2020 est fortement attendue par les pays en développement. Le nouveau ministre de l’environnement indien répète régulièrement que les pays développés doivent joindre le geste à la parole. Son dernier message, juste après la conférence de Bonn, est dépourvu d’ambiguïté : les pays développés ne doivent pas seulement parler de réduction d’émissions, ils doivent également porter plus d’attention à l’adaptation et aux transferts technologiques et financiers afin que les nations pauvres puissent se préparer aux évolutions attendues du climat. A Bonn, la Malaisie, pour le groupe des 77, a souligné que les pays développés devaient verser les financements prévus dans cadre des accords climatiques. La Jordanie, au nom d’une vingtaine de pays en développement, dont l’Inde et la Chine, a souhaité la mise en place d’une trajectoire annuelle jusqu’à 2020 des financements attendus de la part des pays développés : cette trajectoire doit être croissante et atteindre 100 milliards par an en 2020.
Dans la logique de sa proposition, le Brésil a souhaité que les pays du Sud indiquent dans leurs contributions nationales les financements sud-sud qu’ils mettaient en place. Cette contribution, pour positive qu’elle soit, ne saurait faire oublier l’engagement des pays développés qui ont un peu plus d’un an pour trouver les sources de financement nécessaires au respect de leurs engagement financier ou pour définir les montages qui permettront de trouver chaque année un flux de 100 milliards de dollars à partir de 2020. Alors que les Brics viennent de créer en juillet leur propre banque pour le développement, la mise au point des transferts technologiques et financiers attendus par les pays en développement favorisera sans nul doute à la réussite de la Conférence de Paris. Le récent accord sino-américain sur le climat ainsi que l’annonce la semaine dernière d’une contribution de 3 milliards de dollars des Etats-Unis au capital du fonds vert devraient également y contribuer.